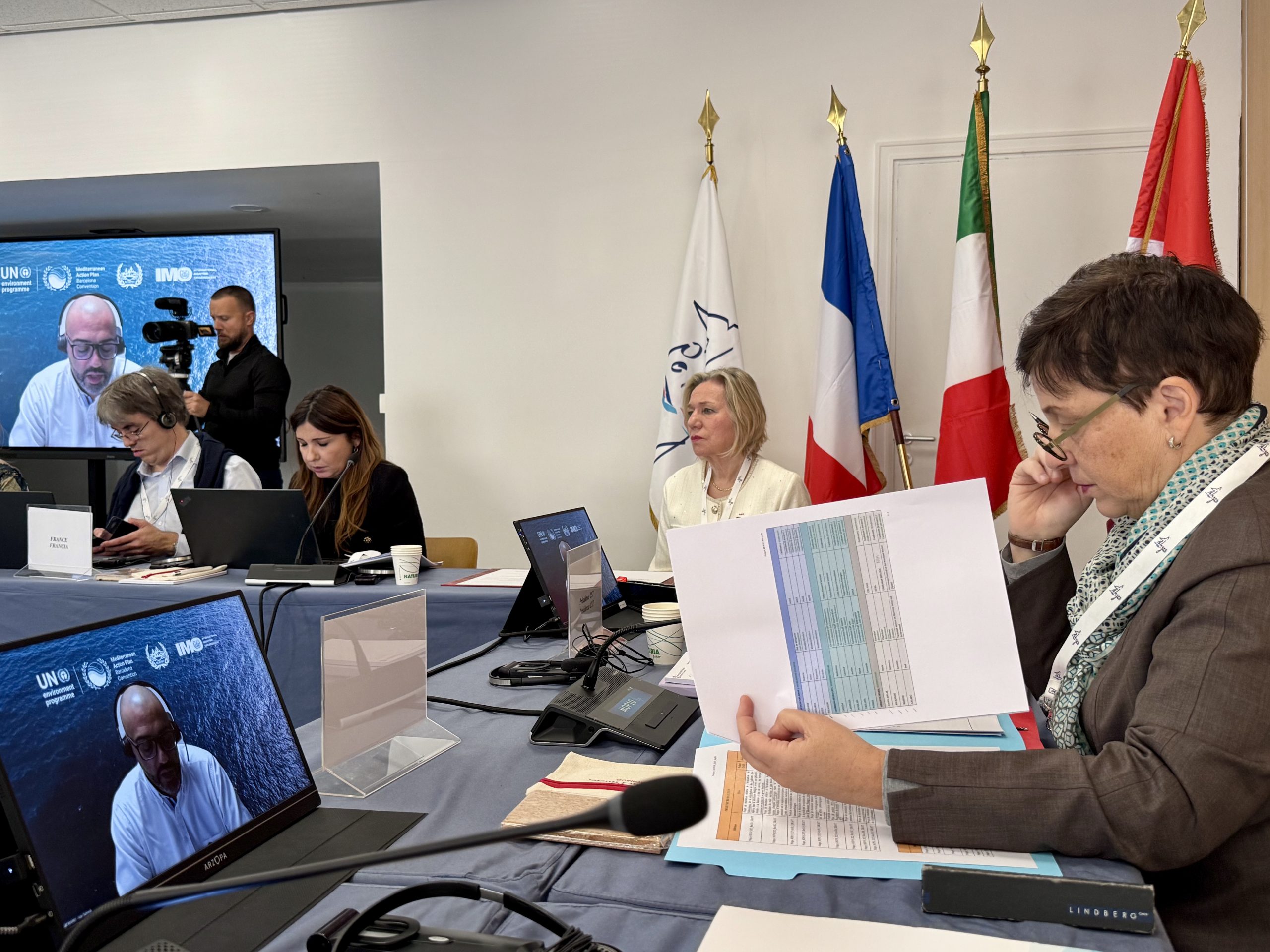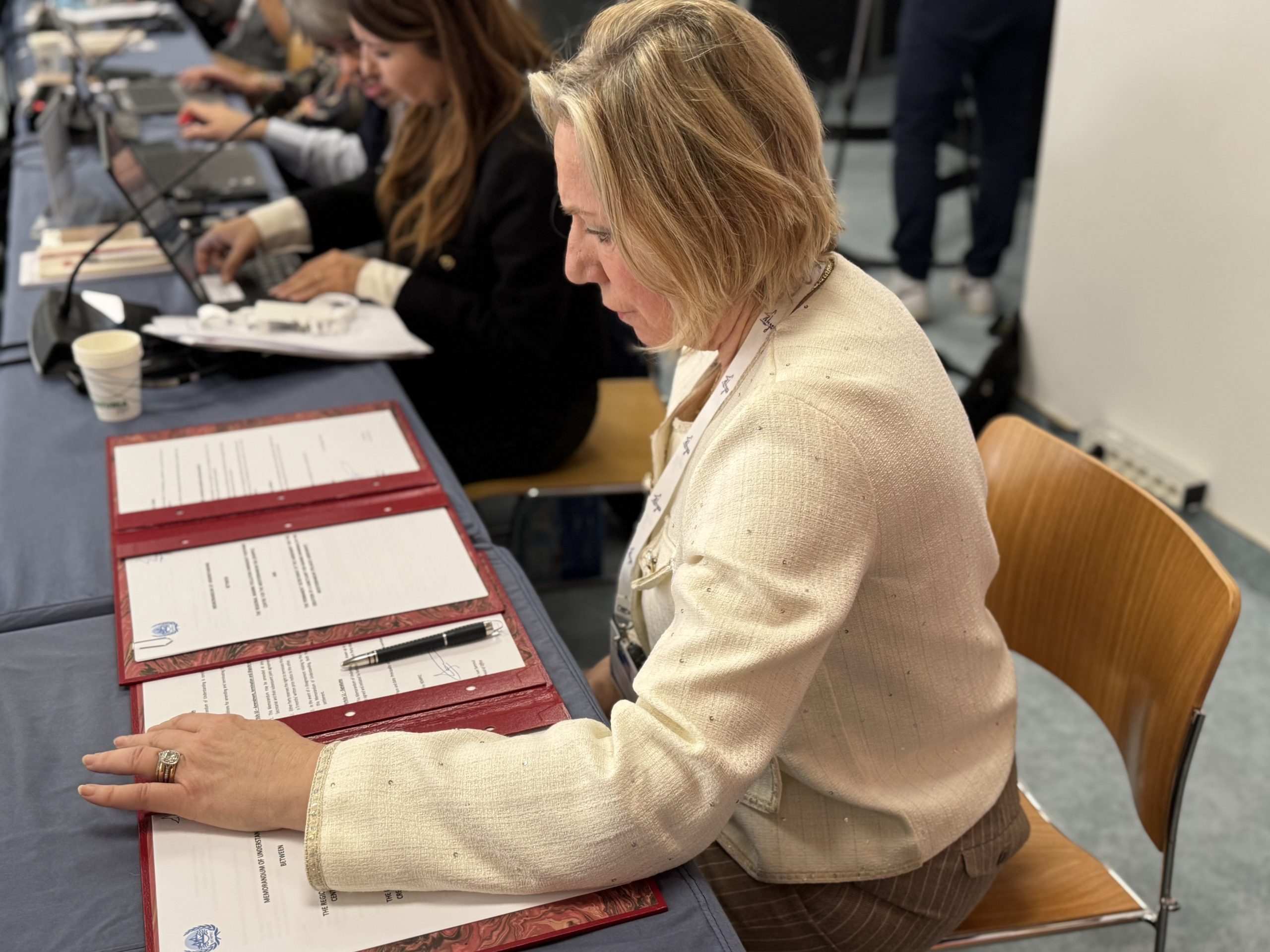Pollution dans le Sanctuaire Pelagos: une étude pour comprendre et protéger
Pollution dans le Sanctuaire Pelagos: une étude pour comprendre et protéger
Parmi les menaces les plus répandues mais souvent sous-estimées figure la pollution chimique et biologique: un problème diffus qui affecte les eaux, les sédiments, les organismes marins et les cétacés eux-mêmes, les exposant à des risques directs et indirects.
Pour mieux cerner l’ampleur de cette menace, l’Accord Pelagos a lancé une expertise scientifique spécifique dans le cadre de son Plan de Travail 2024–2025, confiée à une équipe dirigée par la Professeure Maria Cristina Fossi (Université de Siena), le Dr François Galgani (IFREMER) et le Dr Matteo Baini (Université de Siena). Il s’agit de la première enquête systématique et intégrée sur ce sujet, visant à évaluer l’état actuel de la pollution et les risques pour les espèces clés du Sanctuaire.

Une approche intégrée de l’analyse de la pollution: les cinq phases du projet
Le projet s’est articulé autour de cinq phases opérationnelles, chacune conçue pour construire une vision de plus en plus intégrée et détaillée de l’environnement marin, des pressions exercées sur lui et des impacts sur les cétacés.
- Acquisition des données bibliographiques (2010–2024): Plus de 24 000 points de données ont été extraits de publications scientifiques, de bases de données en libre accès comme EMODNET et LitterBase, de rapports techniques nationaux dans le cadre de la Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (MSFD), et de projets pertinents. Les contaminants étudiés vont des métaux lourds aux polluants organiques persistants (POPs), en passant par les déchets plastiques.
- Revue critique: Après un tri qualitatif, 23 474 points de données fiables ont été retenus, avec coordonnées GPS, méthodes analytiques validées et concentrations comparables. Ces données couvrent quatre matrices environnementales : eau, sédiments, biote (organismes) et déchets marins. Ce jeu de données a permis de créer les cartes de contamination et d’évaluer les risques pour les mammifères marins.
- Cartographie de la contamination: Grâce aux coordonnées géographiques associées aux concentrations de polluants, la distribution spatiale des contaminants dans le Sanctuaire a été cartographiée. Certains, comme les organochlorés (ex. DDT, PCB) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), se sont révélés particulièrement répandus, tout comme les déchets plastiques. 42,5 % de la zone a été analysée pour au moins une classe de polluants, avec une couverture plus importante le long des côtes.
- Carte du risque d’exposition: En croisant les cartes des polluants avec celles de la distribution des cétacés (issues de la consultation scientifique), un Indice de Risque d’Exposition (IRE) a été calculé pour des espèces comme la stenelle rayée, le grand dauphin, le rorqual commun et le cachalot. Cela a permis d’évaluer spatialement le risque potentiel d’exposition aux substances chimiques et déchets plastiques.
- Production d’un livret de sensibilisation: La dernière phase a porté sur la synthèse et la communication des résultats via la création d’un livret intitulé «Anthropogenic Pollutants in the Pelagos Sanctuary», destiné à impliquer les parties prenantes et à diffuser les résultats.

Les résultats: un Bilan contrasté
L’analyse a permis de classifier les zones du Sanctuaire selon leur niveau de contamination, grâce à la méthodologie européenne CHASE+ (Chemical Status Assessment Tool). Plus de 70 % des eaux sont en bon état, mais certaines zones côtières, comme l’archipel toscan, présentent des points critiques. 41 % des sédiments présentent une contamination modérée, suggérant des risques à long terme. Les niveaux de polluants dans le biote sont souvent en dessous des seuils d’alerte, bien que certaines zones critiques aient été identifiées.
La situation la plus préoccupante concerne les déchets marins : plus de 85 % des zones analysées sont classées comme problématiques, avec une forte présence de microplastiques et macroplastiques. La pollution ne se limite pas aux zones côtières ou industrielles : elle est relativement uniforme, ce qui révèle une pression généralisée nécessitant une gestion intégrée, y compris dans les zones pélagiques.
Un Risque Concret pour les Cétacés
Grâce à l’IRE, l’étude montre que la dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) et le grand dauphin (Tursiops truncatus) sont les espèces les plus exposées, en raison de leur présence dans les zones côtières et de surface, proches des sources de pollution anthropique.
Le cachalot (Physeter macrocephalus) et le rorqual commun (Balaenoptera physalus) semblent moins exposés, mais cela pourrait s’expliquer par un manque de données dans les zones pélagiques, où ces espèces sont principalement présentes. Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires pour combler ces lacunes.
Les résultats obtenus constituent une base essentielle pour une gestion du Sanctuaire fondée sur des preuves scientifiques. C’est la première évaluation combinant pollution environnementale et distribution des cétacés, rendue possible par l’approche collaborative des consultants sous l’égide de l’Accord Pelagos.
Le projet met aussi en lumière l’urgence de définir des seuils de référence pour de nombreux polluants émergents, actuellement sans normes réglementaires. Sans ces limites, il est difficile d’évaluer les risques pour l’écosystème marin.
Des recommandations à l’action: une vision pour l’avenir
L’équipe de consultants a élaboré une série de recommandations stratégiques pour renforcer la protection du Sanctuaire: il est essentiel de renforcer le suivi environnemental et biologique, notamment dans les zones peu explorées, comme les zones offshore, et de maintenir une surveillance à long terme pour comprendre l’évolution de la pollution et ses effets sur les cétacés.
Il est tout aussi important de promouvoir l’échange de données entre les institutions et les pays signataires de l’Accord, de constituer des bases de données partagées et actualisées, et d’intégrer ces informations dans les stratégies de planification et de gestion de l’espace marin, en priorisant les zones les plus à risque.