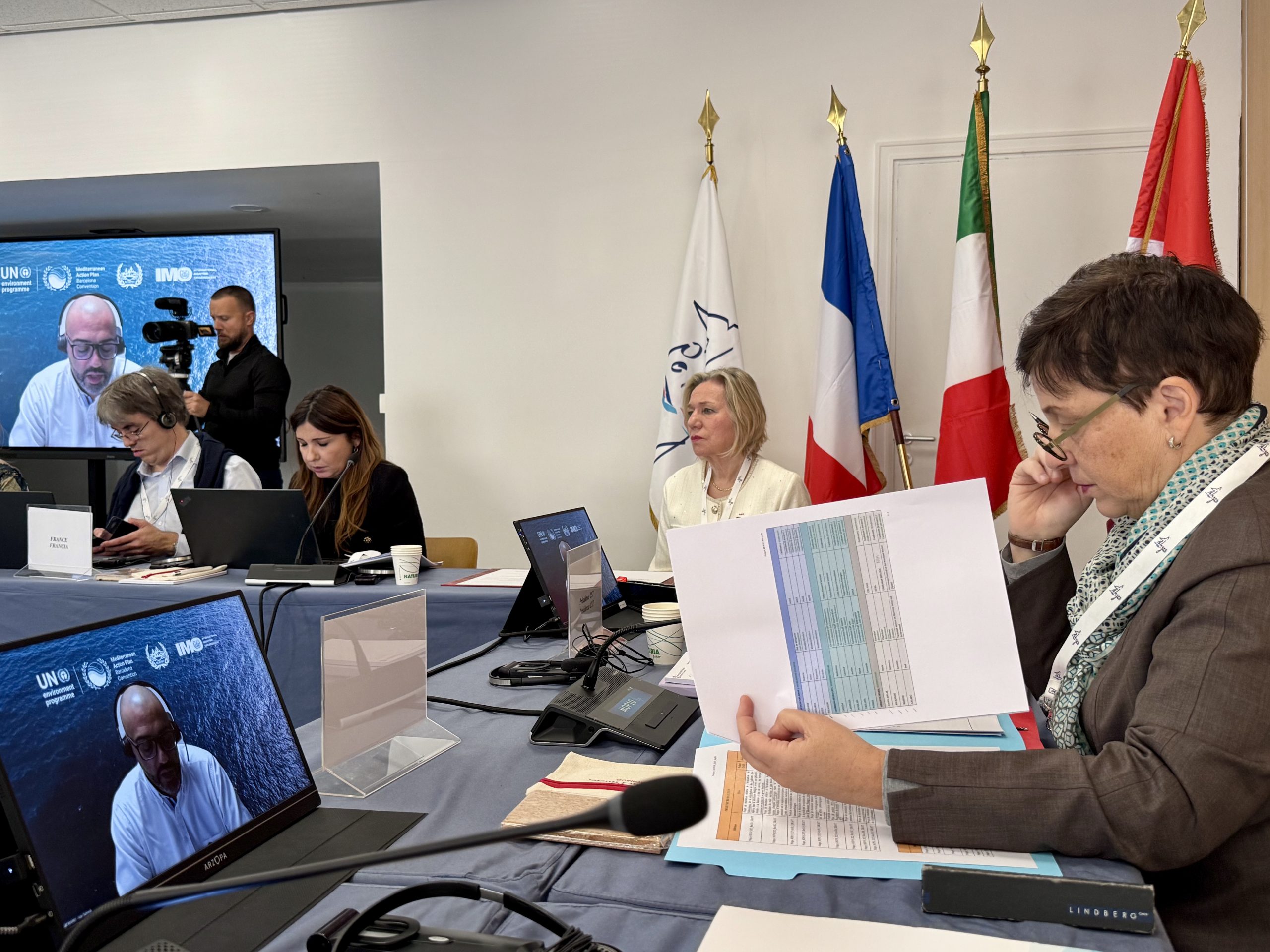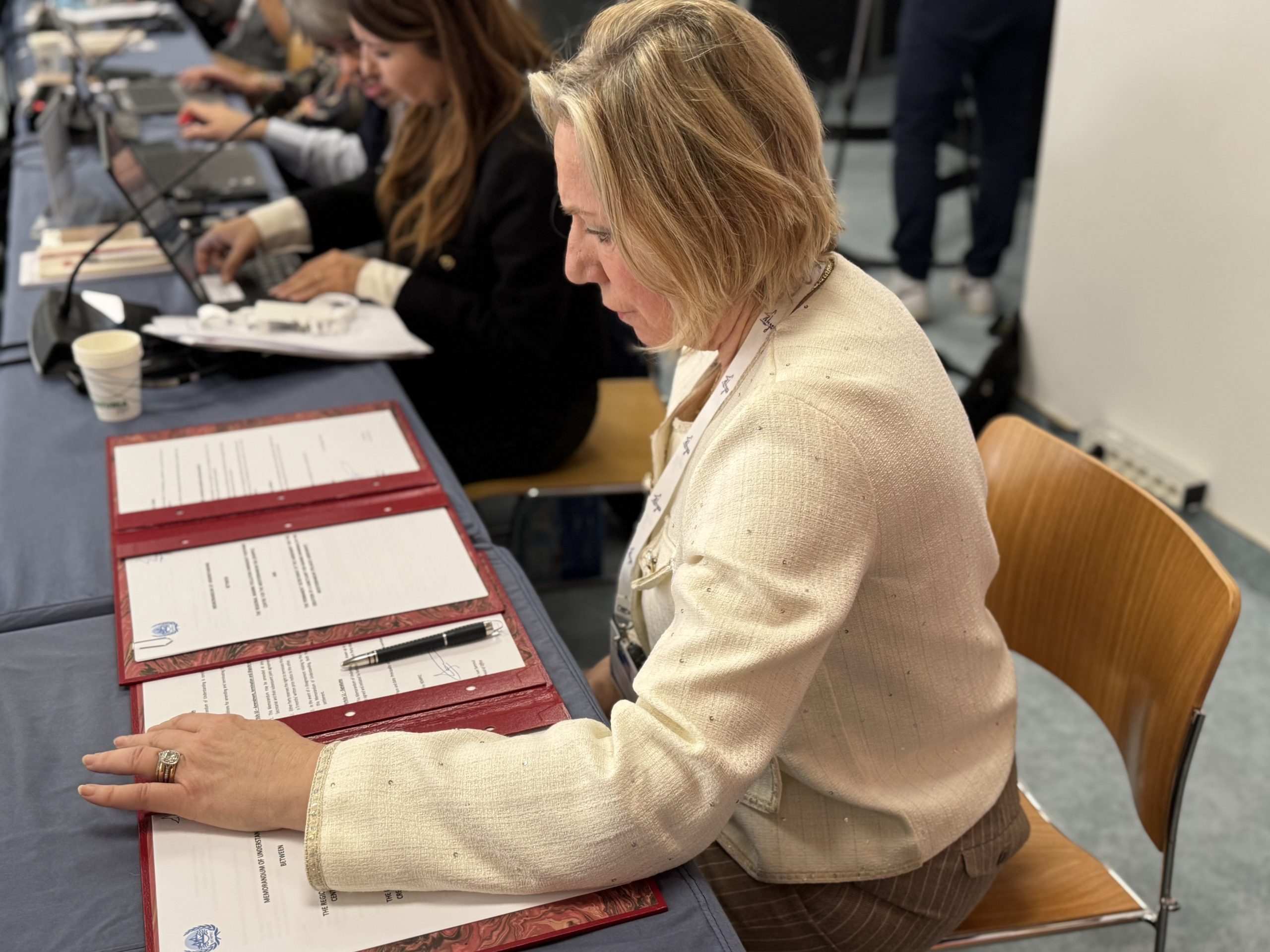Pelagos et le défi de la plaisance: la prochaine étape en Côte d’Azur
Pelagos et le défi de la plaisance: la prochaine étape en Côte d’Azur
L’Accord Pelagos poursuit ses efforts pour approfondir la connaissance du trafic nautique de plaisance dans les ports et marinas de tout le Sanctuaire. Outre les travaux ayant fourni une vision transfrontalière d’ensemble, le projet intitulé “ToR4” marque une étape importante, en appliquant la même méthodologie d’analyse à une zone restreinte mais stratégique: le Département français 06 – Alpes-Maritimes – et les eaux de la Principauté de Monaco. Ici, le long d’un littoral à très forte intensité de trafic et à présence régulière de cétacés, la pression anthropique atteint des niveaux critiques durant les mois d’été, avec des fréquences de navigation plus de trois fois supérieures à celles de la basse saison. Confiée aux consultants Alexandre Gannier et Adrien Gannier, l’étude associe l’évaluation du trafic à la définition de lignes directrices opérationnelles visant à atténuer les perturbations causées par la navigation de plaisance aux mammifères marins du Sanctuaire.
La Côte d’Azur constitue un véritable «laboratoire à ciel ouvert» pour l’étude des interactions entre plaisance et faune marine: 32 ports de plaisance concentrés sur moins de 50 km de côte, avec environ 12 000 places à quai au total. En période estivale, dans des zones comme le Cap d’Antibes, le flux d’embarcations peut dépasser un passage par minute aux heures de pointe, avec des vitesses moyennes supérieures à 15 nœuds et des pics au-delà de 25 nœuds. Ces conditions, associées à la présence régulière de dauphins bleus et blancs, grands dauphins et dauphins de Risso, augmentent de manière significative le risque de collisions et de perturbations acoustiques — deux menaces majeures pour les cétacés côtiers.

Localisation des ports de plaisance dans les Alpes-Maritimes et à Monaco.
Effets directs de la plaisance sur les cétacés
Parmi les impacts directs les plus significatifs de la navigation de plaisance sur les espèces marines :
- Collisions: des cas de mortalité de dauphins bleus et blancs, probablement dus à des chocs avec de petites embarcations, ont été signalés. La vitesse, notamment au-delà de 15 nœuds, est un facteur clé d’augmentation du risque.
- Perturbations comportementales: des approches fréquentes et prolongées peuvent interrompre des activités vitales telles que l’alimentation, le repos et la socialisation, engendrant un coût énergétique important pour les animaux.
- Masquage acoustique: les yachts de taille moyenne à grande vitesse génèrent des niveaux sonores interférant avec la communication et l’écholocalisation des cétacés.
- Observation opportuniste des cétacés (whale watching): le non-respect des distances minimales et du Code de bonne conduite ACCOBAMS-Pelagos accroît le risque de perturbation, tandis que le respect des règles réduit fortement les réactions négatives.

Une matrice des sensibilités aux pressions anthropiques dans les eaux côtières (principalement) de la Côte d’Azur construite selon une approche holistique, incluant une revue de littérature et l’expérience de terrain de l’auteur.
De la cartographie à la stratégie opérationnelle
L’étude a mis à jour l’inventaire des ports de plaisance du Département 06, en les géolocalisant et en les intégrant dans un système SIG incluant également les aires marines protégées, les sites Natura 2000, les zones d’ancrage interdit, les réserves de pêche et les secteurs maritimes à vitesse limitée. L’objectif n’était pas seulement de dresser un état des lieux des infrastructures, mais aussi de les relier aux zones écologiquement sensibles, afin d’identifier les zones de recouvrement entre forte densité de trafic et présence régulière de cétacés.
La collecte de données, réalisée au moyen de questionnaires envoyés à l’ensemble des 32 ports et marinas, a obtenu un taux de réponse de 25 %, suffisant pour mettre en évidence des différences significatives : certains ports disposent de systèmes de collecte des huiles usées et des eaux noires, de points d’information pour les plaisanciers et adhèrent à des codes de conduite ; d’autres, notamment dans les zones à très forte fréquentation, n’ont pas encore mis en place de mesures de mitigation structurées. L’analyse des flux de navigation, basée sur des suivis antérieurs et des observations directes, a confirmé la concentration des sorties entre 9h00 et 12h00 et entre 17h00 et 19h00, avec des densités pouvant en été dépasser 1 500 unités journalières dans certains secteurs côtiers.
Sur la base de ces données, les consultants ont formulé des lignes directrices opérationnelles adaptées au contexte local, qui devraient inclure :
- des campagnes de sensibilisation à destination des plaisanciers et des écoles de navigation, pour promouvoir le respect des distances minimales (100 m) et des vitesses de sécurité en présence de cétacés;
- des limitations de vitesse à 10 nœuds dans des zones spécifiques à forte fréquentation, afin de réduire le bruit sous-marin et le risque de collisions;
- le renforcement des contrôles en mer et des patrouilles coordonnées entre autorités maritimes et garde-côtes;
- des programmes de formation pour les autorités maritimes, afin d’uniformiser les procédures d’observation et d’intervention en cas d’interactions avec les cétacés.
Ces recommandations traduisent les données scientifiques en mesures concrètes et immédiatement applicables, avec pour objectif d’atténuer l’impact de la plaisance sur les espèces les plus sensibles du Sanctuaire.
Un modèle pour l’avenir
La valeur de cette étude ne réside pas seulement dans la réussite d’une analyse locale, mais aussi dans la création d’un modèle reproductible dans d’autres zones critiques du Sanctuaire — démontrant comment la recherche peut se traduire en action concrète pour la protection des cétacés et des écosystèmes marins.